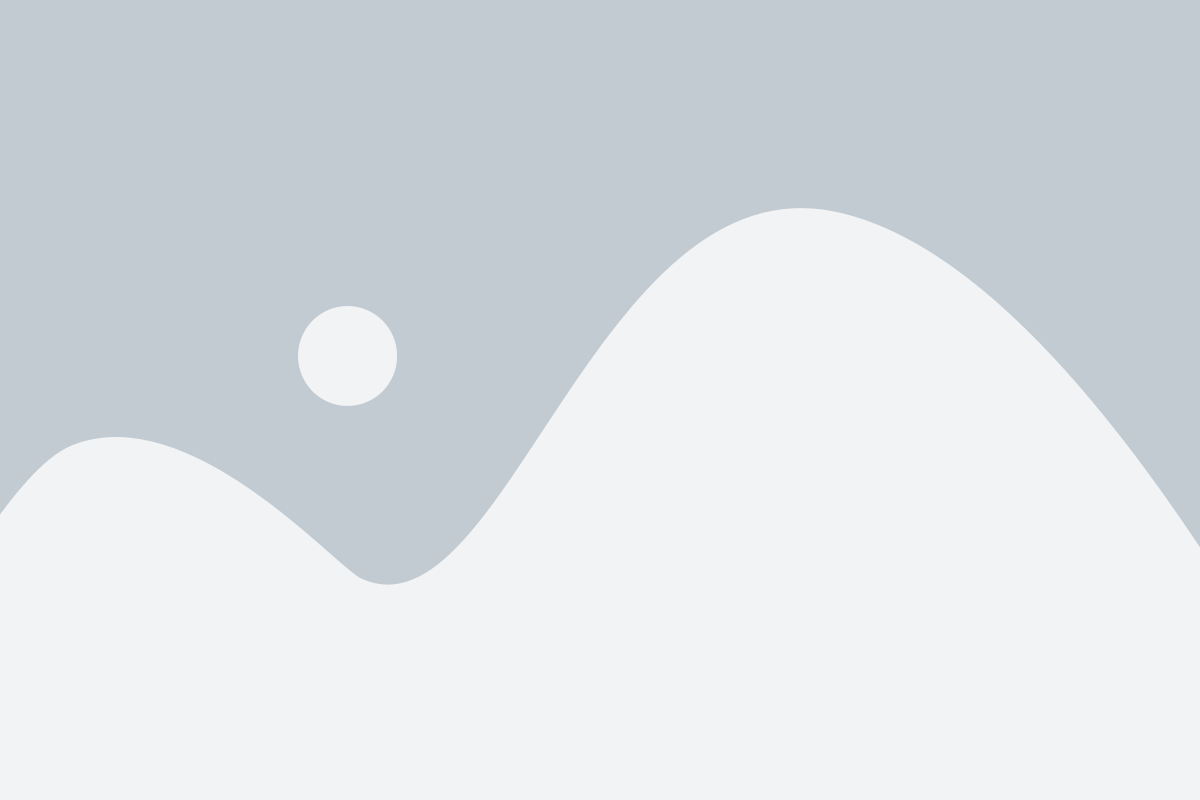Lors de la planification d’un projet photovoltaïque, certains développeurs se demandent s’il vaut mieux investir dès le départ dans une technologie de nettoyage ou sous-traiter à une société spécialisée plutôt que d’accepter les pertes de production dues à l’encrassement des panneaux.
Dans la plupart des cas, les calculs financiers d’un projet PV reposent sur le LCOE (Levelized Cost Of Energy), qui prend en compte les coûts totaux de production sur la durée de vie du système. Actuellement, rares sont les projets qui intègrent directement les coûts liés à l’absence de nettoyage. Pourtant, cette approche gagne du terrain, car elle permet d’anticiper et de minimiser les pertes énergétiques et les risques de dégradation des modules.
Intégrer les coûts de non-nettoyage dès le départ est complexe : il faudrait mesurer sur au moins un an l’impact de l’encrassement spécifique à chaque site, prévoir toute modification environnementale, prendre en compte les événements météorologiques extrêmes et anticiper la formation de lichens ou mousses.
C’est pour cette raison que de nombreux développeurs choisissent aujourd’hui une approche proactive : faire appel à des robots de nettoyage ou à des sociétés spécialisées, qui permettent non seulement de maintenir le rendement optimal, mais aussi de protéger la durée de vie des panneaux. Une session de nettoyage post-saison estivale, par exemple, peut prévenir l’apparition de micro-organismes qui compromettent les cellules PV.
En résumé, les modules photovoltaïques ne produisent jamais à 100 % de leur potentiel si l’encrassement n’est pas géré. Une mesure sur site et une analyse adaptée permettront de déterminer la fréquence optimale de nettoyage et guideront le choix entre automatisation, sous-traitance ou compromis financier.